Le RSAC : un pilier de la salubrité alimentaire au Canada
Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) est entré en vigueur le 15 janvier 2019. Il constitue une avancée majeure dans la réglementation canadienne en matière de sécurité alimentaire. Son objectif principal est d’assurer que les aliments importés, exportés ou destinés au commerce interprovincial soient salubres et conformes aux normes en vigueur.
Le RSAC repose sur une approche préventive, exigeant des entreprises qu’elles mettent en place un plan de contrôle préventif. Ce plan décrit comment les risques pour la salubrité des aliments sont identifiés, maîtrisés et documentés. Il peut inclure des éléments tels que les principes HACCP, les procédures d’hygiène, les règles d’emballage et d’étiquetage, ainsi que la gestion des dangers biologiques, chimiques et physiques.
Contrôle qualité vs assurance qualité : deux approches complémentaires
Une partie essentielle de la présentation a porté sur la distinction entre contrôle qualité et assurance qualité, deux fonctions souvent confondues mais fondamentalement différentes.
- Le contrôle qualité est un processus réactif. Il consiste à effectuer des tests et des analyses à différentes étapes de la production pour s’assurer que les produits respectent les spécifications. Cela inclut la vérification de la matière grasse, du taux d’humidité, du pH, de la conformité organoleptique, et plus encore.
- L’assurance qualité, en revanche, est une démarche proactive. Elle vise à prévenir les erreurs avant qu’elles ne surviennent, en mettant en place un cadre structuré basé sur la réglementation, les référentiels sectoriels (ISO, HACCP, GFSI) et les politiques internes. Elle garantit l’innocuité et la conformité des produits tout au long du processus de fabrication.
Cette distinction est cruciale pour comprendre les rôles et responsabilités des professionnels de la qualité dans une usine de transformation alimentaire.
Le rôle du responsable en assurance qualité : rigueur et polyvalence
Le responsable en assurance qualité joue un rôle stratégique dans toute entreprise agroalimentaire. Il est au cœur du système qualité et veille à ce que les produits soient conformes aux exigences réglementaires et aux standards internes. Voici un aperçu de ses principales responsabilités selon les milieux :
- Former le personnel aux bonnes pratiques industrielles (BPI), à l’hygiène, à la gestion des allergènes et à la réglementation.
- Rédiger et gérer la documentation du système qualité, incluant les plans HACCP, les procédures RSAC, les audits internes et les plans de rappel.
- Assurer la traçabilité des produits et la gestion des plaintes.
- Superviser les écarts et les actions correctives, en s’appuyant sur des analyses de risques et des validations rigoureuses.
- Collaborer avec les autorités réglementaires et les auditeurs externes, notamment dans le cadre de certifications reconnues par la Global Food Safety Initiative (GFSI ).
Dans le secteur laitier, ces responsabilités prennent une dimension particulière. Les produits sont sensibles, les procédés complexes, et les exigences de salubrité très élevées. Le responsable qualité doit donc faire preuve de rigueur, de méthode et d’une grande capacité d’adaptation.
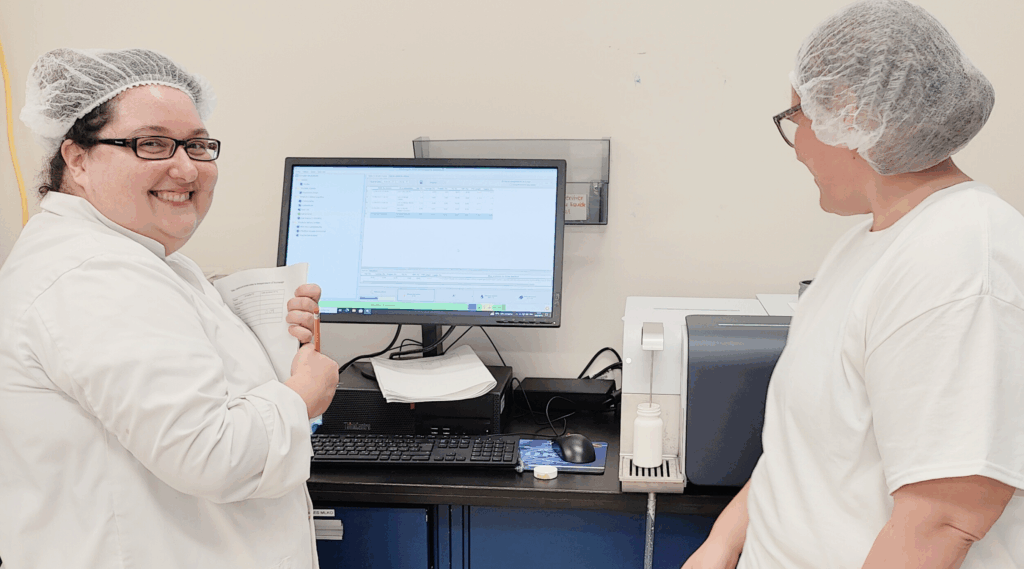
Implanter un système qualité : par où commencer?
L’implantation d’un système qualité conforme au RSAC ou à un référentiel GFSI (comme SQF, BRCGS ou FSSC 22000) est une démarche structurée qui demande rigueur, planification et engagement de l’ensemble de l’organisation. Elle ne se limite pas à la rédaction de procédures : elle implique une transformation des pratiques, une mobilisation des équipes et une culture de salubrité bien ancrée. Voici les étapes clés à suivre :
1. Comprendre la réglementation ou le référentiel à implanter
Le RSAC est un règlement complexe, structuré en plusieurs parties et sous-sections. Les référentiels GFSI, quant à eux, sont des normes privées reconnues internationalement qui intègrent les principes HACCP et vont souvent au-delà des exigences réglementaires. Il faut donc :
- Lire et interpréter les articles du RSAC (ex. : articles 45 à 89) ou les exigences du référentiel GFSI choisi.
- Identifier les obligations spécifiques selon le type de produit, le marché visé (local, interprovincial, exportation) et les attentes des clients.
- Se doter d’outils de vulgarisation ou de guides pratiques pour faciliter la compréhension par les équipes.
2. Analyse d’écarts : poser un diagnostic clair
Avant toute chose, il est essentiel de réaliser une analyse d’écarts (gap analysis) entre les exigences du RSAC, et/ou d’un référentiel GFSI, et les pratiques actuelles de l’entreprise.
Cette étape permet de :
- Identifier les éléments déjà en place (procédures, formations, contrôles).
- Déterminer les lacunes à combler pour atteindre la conformité.
- Prioriser les actions à mettre en œuvre selon leur impact et leur faisabilité.
Un bon diagnostic repose sur une lecture attentive du règlement ou du référentiel, une observation terrain et des entrevues avec les responsables de chaque secteur.
3. Mobiliser les ressources humaines
La réussite de l’implantation repose sur l’implication des ressources humaines. Il faut :
- Identifier les personnes clés (responsable qualité, opérateurs, superviseurs).
- Définir les rôles et responsabilités de chacun dans le système qualité.
- Évaluer les compétences existantes et les besoins en formation.
Les référentiels GFSI exigent également que la direction soit engagée et que le personnel soit sensibilisé à la culture de salubrité.
4. Rédiger les procédures et documents nécessaires
La documentation est au cœur du système qualité. Elle doit être :
- Claire, structurée et accessible.
- Codifiée et mise à jour régulièrement.
- Validée par les responsables et diffusée aux personnes concernées.
Cela inclut les procédures opérationnelles, les plans de contrôle préventif, les registres de surveillance, les fiches de formation, les protocoles de rappel, etc. Les référentiels GFSI exigent aussi des politiques qualité, des objectifs mesurables et des plans d’amélioration continue.
5. Mettre en place des mécanismes de surveillance, de vérification et de validation
Un système qualité efficace repose sur des mécanismes de contrôle à plusieurs niveaux :
- Surveillance : observation régulière des pratiques et des paramètres critiques.
- Vérification : confirmation que les procédures sont suivies et efficaces.
- Validation : démonstration que les mesures mises en place permettent d’atteindre les objectifs de salubrité.
Ces mécanismes doivent être documentés et intégrés dans un calendrier de suivi. Les référentiels GFSI exigent également des audits internes et des revues de direction.
6. Assurer une traçabilité complète
La traçabilité est une exigence fondamentale du RSAC et des référentiels GFSI. Elle permet de suivre le parcours d’un produit, de ses matières premières à sa distribution. Pour cela, il faut :
- Mettre en place des systèmes d’enregistrement fiables.
- Identifier chaque lot de production.
- Documenter les étapes critiques (réception, transformation, expédition).
Une traçabilité efficace facilite la gestion des plaintes, des rappels et des audits.
7. Prévoir des formations continues
La formation est un levier essentiel pour maintenir la conformité et améliorer les pratiques. Elle doit être :
- Planifiée selon les besoins (hygiène, allergènes, procédures, réglementation).
- Documentée (calendrier, fiches de présence, évaluations).
- Réévaluée régulièrement pour s’adapter aux changements réglementaires ou organisationnels.
- Conçue et partagée de façon à capter l’attention des participants et ainsi faire évoluer leur niveau de compétence et de compréhension.
Les référentiels GFSI exigent également que la formation soit adaptée aux rôles et qu’elle contribue à la culture de salubrité.
8. Cartographie des processus et indicateurs de performance
Pour renforcer l’efficacité du système, il est recommandé de :
- Cartographier les processus pour identifier les points critiques et les flux de production.
- Définir des indicateurs de performance (non-conformités, plaintes, actions correctives) pour suivre l’évolution du système.
Les référentiels GFSI exigent un suivi des performances et une amélioration continue.
9. Développer une culture de salubrité alimentaire
Les référentiels GFSI insistent sur l’importance d’établir une culture de salubrité. Cela passe par :
- L’engagement de la direction.
- La responsabilisation des employés.
- La communication interne sur les enjeux de qualité.
10. Préparer les audits internes et externes
Les audits sont des outils de vérification et d’amélioration continue. Il est utile de :
- Planifier des audits internes réguliers.
- Simuler des audits externes pour préparer l’équipe.
- Intégrer les résultats dans les plans d’amélioration.
Les audits de certification GFSI sont réalisés par des tiers indépendants et exigent une préparation rigoureuse.
Une sensibilisation essentielle pour bâtir la relève
La présentation du RSAC et du rôle du responsable en assurance qualité dans le cadre du cours Filière de la transformation laitière de l’AEC Techniques de transformation du lait en produits laitiers (TTLPL) a permis de mettre en lumière les enjeux cruciaux de la salubrité alimentaire. En vulgarisant les notions complexes et en illustrant leur application concrète dans le milieu laitier, cette activité contribue à former une relève mieux préparée à intégrer le secteur agroalimentaire.
La salubrité des aliments n’est pas qu’une obligation réglementaire : c’est une responsabilité envers les consommateurs, une garantie de qualité, et un facteur de compétitivité pour les entreprises. Le métier de responsable en assurance qualité incarne cette mission avec rigueur, expertise et engagement.
Nous sommes là pour vous accompagner dans votre quête de connaissances
Plusieurs formations de groupe en salubrité alimentaires sont offertes dans le catalogue de formations continues.
Le contenu, format ou moment ne vous convient pas? Contactez-nous pour connaître nos offres de personnalisation.

Catherine Leblanc
Conseiller à la formation continue – Secteur alimentaire
Téléphone : 450 778-6504, poste 6400
catherine.leblanc@itaq.ca
LinkedIn





